
L'équipe QHSE Lib
08/06/2025QHSE et gestion de la co-activité sur les plateformes industrielles
Sur les plateformes industrielles, plusieurs entreprises et métiers interviennent simultanément sur un même site, souvent dans des conditions complexes, techniques et contraignantes. Cette situation, appelée co-activité, est source de risques accrus : interférences, mauvaise coordination, confusion des responsabilités.

La gestion de la co-activité est donc un enjeu central en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Elle implique une organisation rigoureuse, une communication fluide et une culture partagée de la prévention. Cet article explore les spécificités de la co-activité en environnement industriel et propose des outils et méthodes pour en maîtriser les risques.
I. Comprendre les risques liés à la co-activité
A. Définition et caractéristiques de la co-activité
La co-activité désigne la présence simultanée de plusieurs entreprises ou équipes sur un même périmètre de travail. Elle peut concerner :
- Des entreprises titulaires et des sous-traitants
- Des équipes internes et des intervenants extérieurs
- Des activités différentes mais géographiquement proches
Exemples typiques : maintenance pendant la production, travaux neufs pendant l’exploitation, livraisons sur zone en chantier actif.
B. Risques générés par les interférences
Lorsque plusieurs acteurs interviennent sans coordination suffisante, les risques augmentent :
- Collision entre engins ou personnes
- Exposition à des nuisances croisées (bruit, poussière, produits chimiques)
- Activation non maîtrisée d’équipements
- Chutes d’objets, dérangements de flux, erreurs de consignation
Ces interférences peuvent provoquer des accidents graves, des arrêts de production, ou des dommages matériels et environnementaux.
C. Enjeux juridiques et responsabilités partagées
Sur le plan réglementaire, l’employeur reste responsable de la sécurité de ses salariés, même en présence d’autres entreprises. Toutefois, la coordination des interventions devient une obligation légale, notamment à travers :
- Le Plan de Prévention (PdP)
- Le Document de coordination SPS (en cas de chantier BTP)
- Les consignes d’accès, de circulation et de travail
Une défaillance dans la gestion de la co-activité peut engager la responsabilité pénale de plusieurs acteurs.
II. Les outils QHSE pour maîtriser la co-activité
A. Le Plan de Prévention : socle réglementaire
Le Plan de Prévention (PdP) est obligatoire pour toute intervention d’une entreprise extérieure de plus de 400 heures ou à risque particulier. Il formalise :
- L’analyse des risques croisés
- Les mesures de prévention spécifiques
- L’organisation des secours et moyens d’alerte
- La définition des zones d’intervention et de circulation
Il est co-rédigé entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure après une visite préalable.
B. La coordination des interventions
En complément du PdP, il convient de désigner un ou plusieurs coordonnateurs QHSE ou sécurité, chargés de :
- Piloter les accueils sécurité
- Vérifier les habilitations et autorisations
- Organiser les réunions de coordination
- Gérer les plannings pour éviter les conflits d’activité
Un planning prévisionnel partagé et mis à jour est un outil simple mais efficace.
C. Les outils visuels et systèmes de communication
Sur le terrain, la co-activité doit être visible et comprise par tous :
- Signalétique claire : zones interdites, flux piétons, engins
- Badges d’identification différenciés (visiteurs, sous-traitants, personnel site)
- Radios ou applications mobiles pour la remontée d’alerte en temps réel
Une communication constante permet de gérer l’imprévu et d’éviter les mauvaises surprises.
III. Retour d’expérience et bonnes pratiques terrain
A. Cas d’un site pétrochimique multi-entreprises
Sur un site accueillant plus de 40 entreprises extérieures par jour, un système de contrôle d’accès digitalisé et de planification centralisée des interventions a été mis en place. Résultat :
- Diminution des incidents liés aux interférences
- Réduction du temps d’arrêt entre interventions
- Amélioration des échanges entre services QHSE
Un animateur sécurité dédié à la co-activité a été nommé, avec une présence terrain renforcée.
B. Témoignage d’un responsable HSE
« La clé, c’est l’anticipation. On ne peut pas improviser la co-activité. Chaque jour, on commence par un brief sécurité inter-entreprises. Chacun sait ce que l’autre va faire, où et comment. C’est ce qui fait la différence. »
Ce type de routine crée une culture partagée de la sécurité, au-delà des différences de statuts ou d’employeurs.
C. Audit et retour d’expérience en fin d’intervention
À la fin de chaque intervention, un bilan QHSE doit être réalisé :
- Événements ou incidents constatés
- Points d’amélioration pour la prochaine co-activité
- Mise à jour du Plan de Prévention pour capitaliser
Ces retours d’expérience permettent l’amélioration continue des pratiques.
Conclusion
La co-activité est inévitable sur les plateformes industrielles. Elle ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme une réalité à organiser intelligemment. Une bonne gestion QHSE de la co-activité repose sur une coordination rigoureuse, des outils partagés et une culture de la sécurité collective. Anticiper les interférences, fluidifier les échanges, renforcer la vigilance : autant d’actions essentielles pour transformer un risque en levier de performance et de confiance entre les parties prenantes.
#QHSE #SécuritéIndustrielle #Coactivité #PlanDePrévention #PlateformeIndustrielle
Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Découvrez les distinctions entre QSE, QSSTE, QHSE, HSE et RS, leurs significations, et comment chaqu ... savoir plus

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteur ... savoir plus

Les équipements de protection individuelle (EPI) jouent un rôle crucial dans la prévention des accid ... savoir plus

L’ergonomie en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon l’Assurance Maladi ... savoir plus
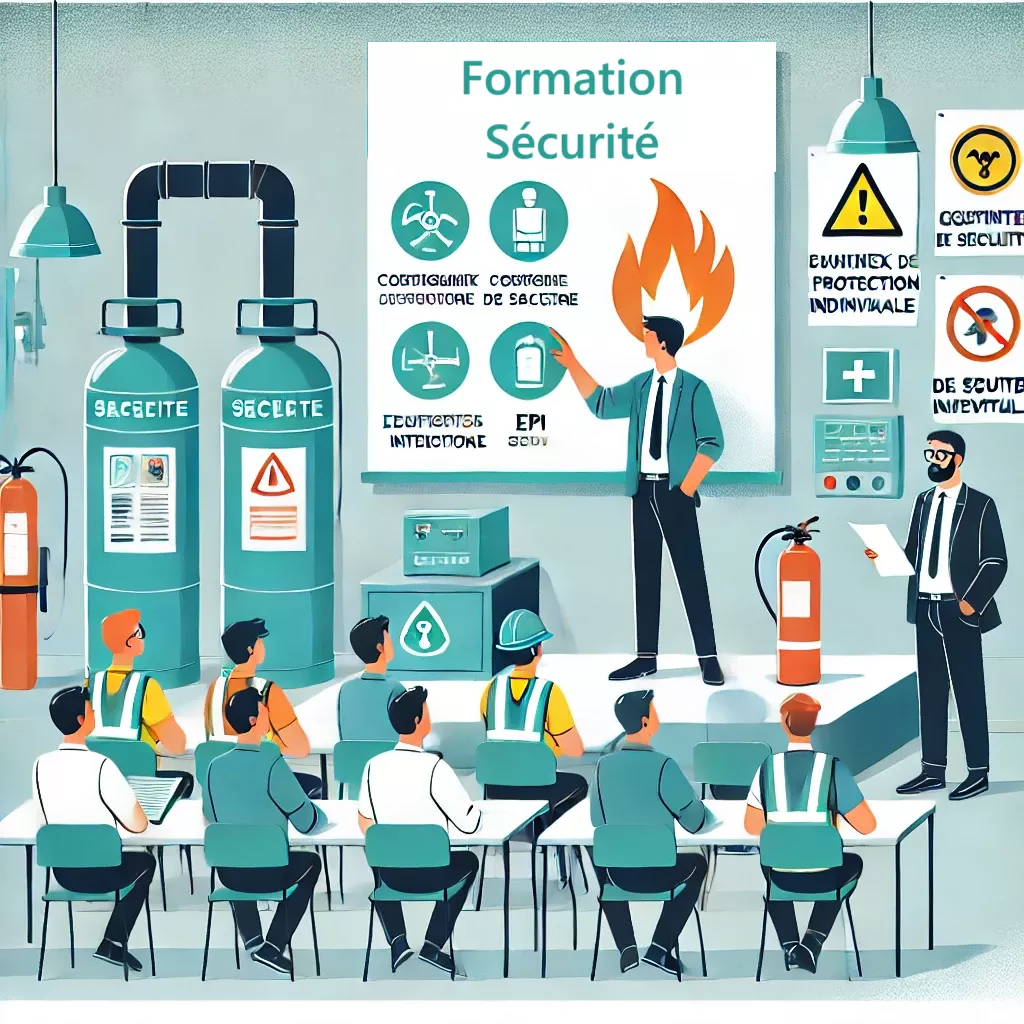
Lorsqu’un nouvel employé rejoint une entreprise, son intégration est une étape clé. Cependant, au-de ... savoir plus

Chaque année, des milliers de travailleurs sont victimes d’accidents sur leur lieu de travail. Si ce ... savoir plus