
L'équipe QHSE Lib
24/06/2025QHSE et qualité de l'air dans les établissements de soins : normes et contrôle
La qualité de l’air dans les établissements de soins constitue une préoccupation primordiale pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être des patients, du personnel soignant et de l’ensemble des visiteurs. Face à la vulnérabilité accrue de ces populations, notamment en période de pandémie ou de gestion bactérienne spécifique, le respect de normes strictes devient une évidence incontournable. Le cadre réglementaire en vigueur, basé sur le référentiel QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), sollicite une vigilance renforcée, fruit d’un processus continu de contrôle et d’amélioration.

Ce sujet soulève néanmoins de nombreuses problématiques : comment définir et assurer la conformité des niveaux de qualité de l’air ? Quelles sont les normes applicables ? Quels mécanismes de contrôle sont mis en œuvre ? Cet article approfondi, destiné aussi bien aux responsables que aux formateurs en QHSE, propose d’analyser ces différentes dimensions pour mieux comprendre les enjeux et les bonnes pratiques associées.
I. Les Normes et Réglementations Encadrant la Qualité de l’Air dans les Établissements de Soins
La gestion efficace de la qualité de l’air repose sur un socle normatif précis, visant à prévenir toute forme de contamination ou de pollution interne et externe. Ces exigences réglementaires s’adaptent à la sensibilité particulière des établissements de soins, qui doivent garantir un environnement sain à chaque instant.
A. Cadre réglementaire national et européen
Depuis plusieurs années, les directives européennes et la législation française ont posé des bases robustes pour encadrer la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public, dont les établissements de santé. La réglementation se concentre essentiellement sur deux axes : la prévention des risques infectieux et la maîtrise des pollutions chimiques et particulaires.
Parmi celles-ci, la norme NF EN 1822 définit, par exemple, les méthodes de filtration pour les systèmes de ventilation, essentielles pour limiter la dispersion de contaminants. La réglementation française insiste également sur l’obligation, pour tout établissement de soins, de réaliser une évaluation périodique des risques liés à la qualité de l’air, conformément à l’article R.4224-17 du Code de la santé publique.
B. NormesISO et directives spécifiques
Les normes ISO, notamment ISO 14644, jouent un rôle fondamental dans la maîtrise et la qualification des zones à haute pureté telles que les salles d’opération ou les chambres d’isolement. La norme ISO 14644 précise notamment les méthodes et les seuils admissibles pour la concentration en particules en suspension dans l’air, classant les environnements en différentes classes de propreté.
Les directives spécifiques comme Guideline for Air Quality in Healthcare Buildings (WHO) ou les recommandations de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) recommandent également des stratégies à adopter pour un contrôle optimal de la qualité de l’air.
C. Normes relatives à la ventilation et à la filtration
Le système de ventilation constitue un vecteur clé pour assurer la qualité de l’air dans ces environnements sensibles. La norme NF EN 13779 fixe les exigences relatives à la conception, à l’installation et à l’exploitation des systèmes de ventilation. L’objectif est d’assurer un renouvellement régulier de l’air, tout en limitant la recirculation de particules ou agents pathogènes.
Les filtres à haute efficacité (HEPA, ULPA) doivent répondre à des normes spécifiques (H13, H14) pour garantir une filtration optimale, notamment en zones stériles.
II. Les Contrôles et Méthodes d’Assurance de la Qualité de l’Air
Garantir la conformité réglementaire ne peut s’opérer sans un dispositif robuste de contrôle. Celui-ci doit associer diagnostic initial, surveillance continue et actions correctives adaptées.
A. L’évaluation initiale et la qualification des espaces
Avant toute mise en service des locaux, une évaluation précise de la qualité de l’air doit être réalisée, intégrant un diagnostic des systèmes de ventilation, des matériaux de construction ou de décoration susceptibles de libérer des polluants. La qualification initiale doit respecter les exigences des normes ISO, notamment en mesurant la concentration en particules, composés volatils ou micro-organismes.
Les résultats servent à établir un référentiel de performance pour la zone concernée, ainsi qu’un plan d’actions correctives si nécessaire. Cette étape est essentielle pour définir le taux de renouvellement d’air, la filtration et la pressurisation requise.
B. La surveillance régulière et la traçabilité
La surveillance en continu ou en périodicité déterminée constitue un enjeu central pour assurer la conformité dans le temps. Elle se traduit par la mise en œuvre de capteurs connectés mesurant la concentration en particules, la qualité microbiologique ou la présence de composés organiques volatils (COV).
Les prélèvements d’air, réalisés par des laboratoires certifiés, permettent également de détecter d’éventuelles problématiques de contamination microbiologique. La traçabilité de ces contrôles doit être rigoureuse, intégrant notamment la gestion d’un registre des résultats, des interventions ou des anomalies constatées.
C. L’utilisation d’outils technologiques et d’algorithmes prédictifs
Avec l’avènement des technologies intelligentes, des logiciels de gestion de la qualité de l’air ont été développés pour analyser en temps réel les données collectées et anticiper d’éventuels défaillances du système. La maintenance prédictive, basée sur l’intelligence artificielle, limite les risques d’interruption de service ou de pollution.
De plus, la surveillance des débits, des pressions et des défaillances de filtration permet d’adopter une posture proactive pour garantir une ventilation efficace et une atmosphère saine.
III. Approches d’Amélioration Continue et Bonnes Pratiques
La maîtrise de la qualité de l’air ne peut se limiter à un simple respect des normes ; elle doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue, intégrée à la stratégie globale de gestion des risques en santé.
A. La sensibilisation et la formation du personnel
Les équipes en charge de la maintenance, du nettoyage ou de la gestion des locaux jouent un rôle crucial dans la prévention. La formation régulière sur les enjeux liés à la qualité de l’air, ainsi que sur les bonnes pratiques de comportement, contribue à minimiser les risques d’altération de l’environnement intérieur.
Il est essentiel de sensibiliser les agents aux consignes d’entretien des systèmes de ventilation, au choix des matériaux et à la gestion des produits chimiques utilisés.
B. La maintenance préventive et la gestion des incidents
Un programme de maintenance rigoureux des systèmes de ventilation et de filtration doit être mis en place. Cela inclut le nettoyage régulier des filtres, la vérification des débits, ainsi que la calibration des capteurs. La réponse rapide à toute anomalie permet de limiter l’impact à la qualité de l’air.
Par ailleurs, un plan de gestion des incidents, comme l’apparition d’une contamination microbiologique ou la défaillance d’un système, doit être établi pour réduire au maximum la durée d’exposition et assurer la sécurité des occupants.
C. L’intégration de la démarche QHSE dans la gouvernance des établissements
Une gouvernance forte, intégrant la gestion de la qualité de l’air dans la politique globale de l’établissement, favorise la synergie entre les différents acteurs. La mise en place d’indicateurs de performance, la revue périodique des résultats et l’engagement de la direction sont indispensables pour progresser durablement.
L’utilisation d’audits internes et externes permet également d’identifier les axes d’amélioration et de vérifier le respect des normes en vigueur.
Conclusion
Assurer une qualité de l’air optimale dans les établissements de soins demeure un défi complexe, mêlant cadre réglementaire précis, contrôle rigoureux et une démarche d’amélioration continue. La prévention, la surveillance et la formation sont les piliers d’une gestion efficace, garantissant la sécurité sanitaire pour tous.
Face à l’évolution des risques et aux avancées technologiques, comment les établissements de santé peuvent-ils continuer à innover pour anticiper les enjeux futurs liés à la qualité de l’air ? La réponse réside sans doute dans une posture pro-active et une vigilance permanente, adaptée aux spécificités de chaque environnement.
Et vous, quelles stratégies mettez-vous en œuvre dans votre établissement pour optimiser la gestion de la qualité de l’air ? Êtes-vous prêts à intégrer les nouvelles technologies pour renforcer votre démarche QHSE ?
#QHSE #QualitéDeLAir #Santé #Sécurité #Environnement #Hygiène #Ventilation #Normes #Contrôles #GestionDesRisques #Prevention #Innovation #SantéPublique
Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Découvrez les distinctions entre QSE, QSSTE, QHSE, HSE et RS, leurs significations, et comment chaqu ... savoir plus

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteur ... savoir plus

Les équipements de protection individuelle (EPI) jouent un rôle crucial dans la prévention des accid ... savoir plus

L’ergonomie en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon l’Assurance Maladi ... savoir plus
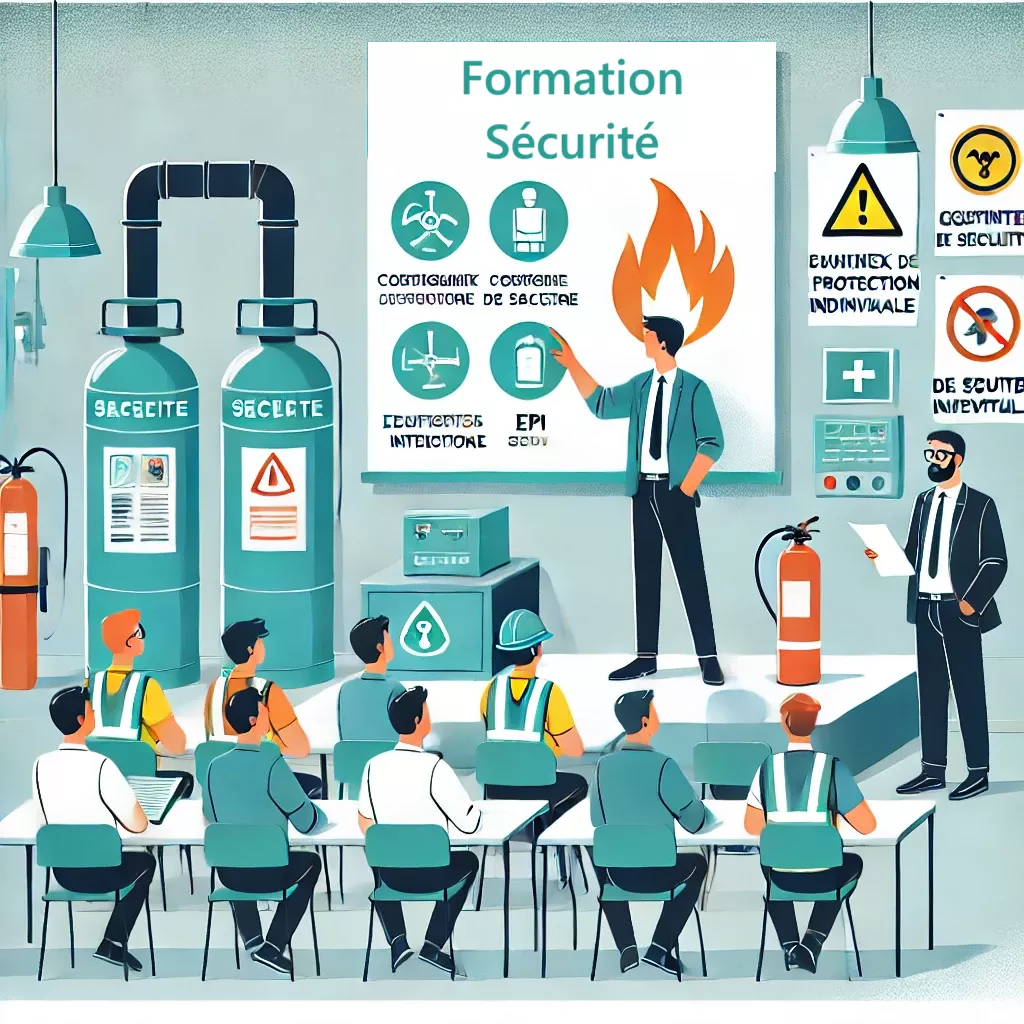
Lorsqu’un nouvel employé rejoint une entreprise, son intégration est une étape clé. Cependant, au-de ... savoir plus

Chaque année, des milliers de travailleurs sont victimes d’accidents sur leur lieu de travail. Si ce ... savoir plus