
L'équipe QHSE Lib
07/08/2025SST et DUERP : comment intégrer les secouristes dans la politique de prévention ?
Dans un environnement professionnel moderne où la sécurité et la santé des salariés sont devenues une priorité incontournable, la prévention des risques constitue la pierre angulaire de toute démarche qualité, hygiène, sécurité, et environnement (QHSE). Parmi les acteurs clés de cette politique, les sauveteurs secouristes du travail (SST) jouent un rôle essentiel, mais leur contribution est-elle suffisamment reconnue et intégrée dans l’ensemble des dispositifs de prévention tels que le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) ?

L’intégration efficace des secouristes dans la démarche de prévention offre non seulement une réponse rapide et adaptée lors des événements indésirables, mais participe aussi à la sensibilisation globale, à la formation continue et à l’amélioration continue de la gestion des risques. Cet article propose d’explorer en profondeur comment optimiser la collaboration entre SST et le DUERP, afin de renforcer la culture sécurité au sein des entreprises, tout en respectant la réglementation et en adoptant une démarche proactive.
I. La place stratégique des SST dans la démarche de prévention
A. Le rôle fondamental du Sauveteur Secouriste du Travail dans l’organisation en entreprise
Le SST est bien plus qu’un simple intervenant lors d’accidents : il représente un acteur clé de la prévention, doté d’une formation spécifique permettant une intervention efficace tant en prévention qu’en gestion de crises. Sa mission ne se limite pas à l’intervention d’urgence, mais englobe également la sensibilisation des collègues, l’évaluation des risques et la participation aux actions de prévention.
La norme européenne NSQ 9001 et la règlementation française (Code du travail, notamment l’article R4224-15 et suivants) soulignent l’importance de la présence de SST formés pour renforcer la sécurité collective. Il convient également de souligner que leur rôle s’articule dans la continuité entre prévention, intervention et suivi, ce qui nécessite à la fois une formation effectuée régulièrement et une reconnaissance institutionnelle au sein de l’organisation.
B. La synergie avec les autres acteurs de la prévention
Les SST ne doivent pas œuvrer isolément. Leur efficacité repose sur une collaboration étroite avec d’autres acteurs : responsables sécurité, médecins du travail, équipes de prévention, et bien entendu, les référents en santé au travail. L’intégration de leur expertise dans les démarches d’évaluation et d’action permet de renforcer la pertinence des mesures préventives adoptées.
Les actions de sensibilisation qu’ils organisent, comme les campagnes de prévention ou les démonstrations d’utilisation d’équipements de protection, contribuent à créer une dynamique collective axée sur la responsabilisation de chacun.
C. La formation continue et la reconnaissance des compétences
Pour garantir leur efficacité, les SST doivent suivre des formations régulières, conformément à la réglementation (au moins tous les deux ans), mais aussi bénéficier d’un parcours d’intégration et de reconnaissance interne. La valorisation de leur rôle incite à une implication plus active et enrichissante dans la politique globale de l’entreprise.
II. Intégrer les SST dans le processus d’évaluation des risques : le lien avec le DUERP
A. L’importance du DUERP comme outil central de prévention
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels est à la fois un outil de diagnostic et un référentiel permettant de prioriser et planifier des actions correctives. La loi française impose à toute entreprise de le tenir à jour, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés.
Il doit contenir une analyse détaillée des risques identifiés, qu’ils soient physiques, chimiques, biologiques ou psychosociaux, ainsi que les mesures de prévention et de réduction des risques préconisées.
B. La contribution des SST à l’évaluation des risques
Les SST, par leur proximité et leur expertise pratique, possèdent une connaissance concrète des risques liés aux situations d’intervention et à l’environnement de travail. Leur participation à la rédaction, à la mise à jour et à la validation du DUERP est donc stratégique.
Ils peuvent apporter des éléments précis sur :
- La nature et la fréquence des accidents ou incidents observés ;
- La vétusté ou l’inadéquation des équipements ;
- La pertinence des procédures d’intervention ;
- La nécessité de formations additionnelles ou d’encourager des comportements sécuritaires.
Une collaboration structurée avec le service prévention permet d’incorporer leur retour d’expérience dans la gestion globale des risques.
C. Mettre en place une démarche participative
L’intégration des SST dans la démarche d’évaluation ne doit pas être limitée à des réunions ponctuelles. Il s’agit d’instaurer une relation continue, où leur retour d’expérience est systématiquement considéré lors des visites d’évaluation, dans la mise à jour régulière du DUERP, et lors des audits de sécurité.
L’instauration de réunions trimestrielles, où SST, responsables sécurité et acteurs RH échangent sur les risques émergents, facilite cette dynamique participative. La valorisation de leur expertise contribue ainsi à une démarche d’amélioration continue orientée vers la réduction effective des accidents et incidents.
III. Inciter et structurer la participation des secouristes au sein de la prévention
A. La formation à la prévention ciblée des SST
Au-delà de leur formation initiale en premiers secours, il est pertinent d’intégrer des modules spécifiques liés à la prévention des risques professionnels, notamment en ergonomie, en gestion du stress ou en sécurité incendie.
Ces formations renforcent leur capacité à anticiper, repérer et contribuer à la réduction des risques, tout en améliorant leur posture lors d’intervention.
B. La création d’un réseau interne de secouristes prévention
Mettre en place un réseau structuré de SST, avec des référents locaux ou des équipes régionales, permet de diffuser plus efficacement une culture sécurité proactive. Ces référents peuvent organiser des ateliers, des formations internes et des campagnes ciblées.
Ce réseau facilite ainsi une veille participative sur les risques et constitue un relais indispensable pour sensibiliser l’ensemble du personnel.
C. L’évaluation et la reconnaissance formelle de leur rôle
L’engagement des SST doit être officiellement reconnu, par des dispositifs d’évaluation régulière, mais aussi par une valorisation visible dans la politique de gestion des ressources humaines.
Ils peuvent, par exemple, si cela est prévu, intervenir lors des réunions annuelle de sécurité ou faire partie du comité de prévention, soulignant ainsi leur rôle fondamental dans la stratégie globale de sécurité de l’entreprise.
Conclusion
L’intégration efficace des secouristes SST dans la politique de prévention ne doit pas se limiter à leur formation initiale ou à leur présence lors d’accidents. Il s’agit d’instaurer une démarche participative, structurée et reconnue, qui valorise leur proximité, leur expertise pratique, et leur rôle d’acteurs clés de la sécurité au sein de l’entreprise.
Face à l’évolution constante des risques professionnels, comment pouvons-nous faire évoluer encore davantage leur rôle pour renforcer durablement la prévention collective ?
La réponse réside peut-être dans une meilleure reconnaissance institutionnelle, une formation continue adaptée, et une implication renforcée dans la gestion globale des risques.
#QHSE #Sécurité #SantéAuTravail #DUERP #SST #Prévention #RisquesProfessionnels #CultureSécurité #Formations #EngagementCollectif
Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Découvrez les distinctions entre QSE, QSSTE, QHSE, HSE et RS, leurs significations, et comment chaqu ... savoir plus

La sécurité au travail est un enjeu majeur pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteur ... savoir plus

Les équipements de protection individuelle (EPI) jouent un rôle crucial dans la prévention des accid ... savoir plus

L’ergonomie en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon l’Assurance Maladi ... savoir plus
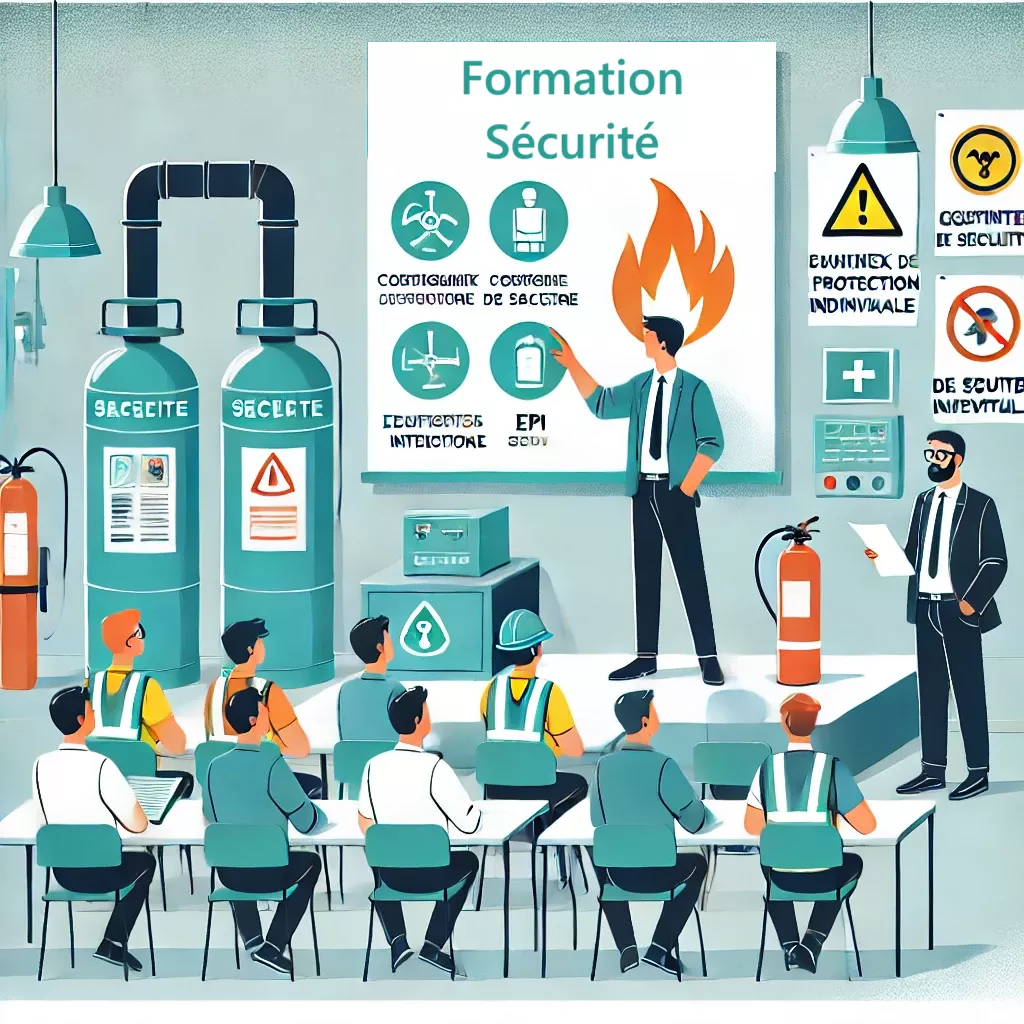
Lorsqu’un nouvel employé rejoint une entreprise, son intégration est une étape clé. Cependant, au-de ... savoir plus

Chaque année, des milliers de travailleurs sont victimes d’accidents sur leur lieu de travail. Si ce ... savoir plus